Quand on parle d’énergie nucléaire, il s’agit presque toujours de la production d’électricité dans des réacteurs nucléaires grâce à la fission par les neutrons des gros noyaux d’uranium assemblés dans leur cœur. Mais il est une autre forme d’énergie nucléaire qui en est, en quelque sorte, l’inverse : la production d’énergie vient de la « fusion » de noyaux très petits, des isotopes de l’hydrogène. C’est analogue aux réactions qui produisent l’énergie des étoiles, depuis leur formation. Cette deuxième forme d’énergie nucléaire n’est pas encore maîtrisée et les difficultés de nature physique et technique encore à résoudre sont considérables, mais son potentiel est énorme. Qu’il s’agisse, comme actuellement et pour le siècle qui s’ouvre, de fissionner des noyaux lourds ou, à échéance plus lointaine, de fusionner des noyaux légers, les possibilités offertes par le nucléaire sont vastes. Quelles que soient les techniques utilisées, les processus mis en œuvre ont un point commun : ils requièrent peu de matière et peu d’espace pour produire beaucoup d’énergie, sans ajouter à l’effet de serre. Pour répondre à la crise énergétique et climatique qu’il faut affronter sans attendre, ces propriétés sont des atouts inestimables. À nous de les exploiter intelligemment pour que le nucléaire apporte au développement de la planète la plus utile des contributions.
Généralités : fission et fusion
La masse d’un noyau est (de peu) inférieure à la somme des masses des protons et des neutrons qui le constituent. Depuis la fameuse équation d’Albert Einstein E = mc², on sait que ce petit défaut de masse correspond à une grande énergie, qu’on appelle énergie de liaison. Inversement, l’énergie de liaison est la quantité d’énergie qu’il faut dépenser pour séparer un noyau au repos en ses constituants, au repos également. Si on divise cette énergie par le nombre total de nucléons (protons et neutrons), on a une mesure de la solidité de l’assemblage : plus ce nombre est élevé, plus le noyau est solide. La courbe ci-après (page 64) représente cette quantité en fonction du nombre de nucléons (autrement dit, de la masse atomique). On y voit que le noyau du fer est le plus solide de tous.
Dans la partie droite de la courbe, on voit la fission : la somme des masses de l’uranium 235 et du neutron qu’il va absorber est inférieure à la somme des masses des deux produits de fission ici représentés (Krypton 94 et Baryum 139) et de celles des trois neutrons émis. Par conséquent, puisque le système a perdu un peu de masse (à peine un cinquième de la masse d’un proton…), il a relâché une grande quantité d’énergie (1), en l’occurrence 200 millions d’électronvolts (eV).
Par comparaison, la réaction chimique bien connue C+O2 → CO2 libère à peine 5 eV. La fission d’un gramme d’uranium produit plus d’énergie que la combustion d’une tonne de pétrole.
Regardons maintenant la partie de la courbe à gauche du fer. De même qu’en fissionnant un noyau lourd en deux noyaux plus légers, on libère l’énergie qui correspond au défaut de masse, en fusionnant deux noyaux légers pour constituer un noyau plus lourd, on libérera également beaucoup d’énergie. Si la fission est – relativement – facile, parce que le neutron n’a pas de charge électrique, la fusion l’est beaucoup moins, car les noyaux légers ont tous les deux une charge électrique de même signe : ils résistent donc vigoureusement aux tentatives de les rapprocher…
La fission a été découverte en 1938, année où le physicien Hans Bethe a constaté que l’énergie du Soleil et des autres étoiles provenait de réactions de fusion, qui transmutaient l’hydrogène en hélium, puis l’hélium en carbone, etc. Les étoiles sont gigantesques et la gravité qui règne en leur centre est si forte qu’elle surpasse la répulsion électrostatique (la barrière coulombienne, dit-on parfois), permettant à la fusion de se produire.
Dans les étoiles, la fusion se passe en deux étapes : d’abord, deux protons fusionnent en un noyau de deutérium en émettant un « positon », particule analogue à l’électron, mais chargée positivement. Puis, deux noyaux de deutérium se fondent en un noyau d’hélium. La première réaction est très, très lente à se produire… et tant mieux ! C’est pour cela que le Soleil « brûle » doucement sa réserve d’hydrogène et qu’on peut espérer le voir briller quatre ou cinq milliards d’années de plus. Mais elle est si lente qu’il est sans espoir de vouloir la reproduire sur Terre.
La seule réaction de fusion qui semble à notre portée met en jeu deux isotopes de l’hydrogène, le deutérium (D) dont le noyau est composé d’un proton et d’un neutron et le tritium (T) qui a un neutron de plus : quand un noyau de deutérium et un noyau de tritium fusionnent, ils produisent un noyau d’hélium et un neutron, en dégageant une énergie de 17,4 MeV.
Le deutérium se trouve en très faible proportion dans l’hydrogène naturel : il suffit de le séparer. Le tritium, lui, est radioactif : il se désintègre avec une période de seulement douze ans. On ne le trouve donc plus dans la nature. Il faut le fabriquer en faisant absorber un neutron par l’isotope de masse 6 du lithium (qu’il faut donc également séparer de son frère de masse 7). Il est donc important de ne pas perdre le neutron de la réaction de fusion : on en aura besoin pour refabriquer du tritium !
Malheureusement, l’essentiel de l’énergie produite, 14 MeV, est emportée par le neutron et difficile à récupérer, et un neutron de 14 MeV produit beaucoup de dommages dans les matériaux solides.
La gravité terrestre est bien trop faible pour forcer les noyaux D et T à se rapprocher suffisamment pour fusionner. Il faut donc trouver une autre solution. Le premier moyen découvert pour réaliser la fusion nucléaire sur Terre a été de comprimer un mélange (D‑T) par la pression gigantesque des rayonnements d’une explosion nucléaire « classique » : c’est la bombe H, ou thermonucléaire, réalisée fin 1952 par les États-Unis et dès l’année suivante par l’URSS. Ce procédé est terriblement efficace pour réaliser des explosions monstrueuses, mais il est un peu trop brutal pour envisager d’en tirer une source d’énergie continue et stable ! Cela fait plus d’un demi-siècle qu’on s’acharne à en trouver un autre…
La fusion par confinement magnétique (FCM)
La voie la plus prometteuse est celle du confinement magnétique. Si on porte un gaz à très, très haute température, les électrons se désolidarisent des noyaux qui deviennent des ions, et l’ensemble devient un plasma, qui est le quatrième état de la matière (après solide, liquide et gaz). Si on porte un mélange de deutérium et de tritium à une température de 100 millions de degrés, les ions D et T acquièrent de telles vitesses qu’ils finissent par ne plus pouvoir s’éviter et entrent en fusion.
Cent millions de degrés, c’est énorme. On comprend qu’il ne peut y avoir aucun contact entre un plasma aussi chaud et n’importe quelle paroi matérielle : celle-ci se volatiliserait instantanément et le plasma se refroidirait brutalement, arrêtant toute réaction de fusion. Il a donc fallu inventer des machines qui permettent de « contenir » le plasma en lévitation par une combinaison de champs magnétiques et électriques. Le tokamak a ainsi été inventé dans les années 1960 par l’équipe de Lev Artsimovitch en URSS.
Le plasma de très faible densité – 100 000 fois plus faible que la densité de l’air à pression et température normales – et très haute température est confiné à l’intérieur d’une chambre à vide de forme torique. Ce plasma est conducteur et constitue le circuit secondaire d’un gros transformateur : on y induit un courant électrique de très forte intensité qui le chauffe par effet Joule. La combinaison de ce champ électrique « pulsé » et des champs magnétiques créés par deux familles d’électroaimants (bobines « poloïdales » et bobines « toroïdales » sur le schéma ci-contre) qui entourent la chambre forme une bouteille magnétique qui force les particules du plasma à rester confinées sans toucher les parois. Comme cet effet n’est pas suffisant, il faut injecter dans le plasma de grandes quantités d’énergie par des moyens de chauffage auxiliaires (antennes de radiofréquences, injection d’atomes neutres).
Les meilleures performances mondiales sont détenues depuis 1997 par le tokamak européen Joint European Torus (JET), situé près d’Oxford, qui a produit 16 MW (thermiques) de fusion D‑T pendant environ une seconde, alors qu’on lui injectait une puissance de chauffage de 24 MW. Le record de durée de confinement du plasma appartient au plus petit tokamak Tore-Supra, situé à Cadarache, dont les bobines magnétiques sont supraconductrices, refroidies à l’hélium liquide : ce record est légèrement supérieur à six minutes.
Il y a plusieurs autres configurations possibles pour réaliser le confinement magnétique, notamment le stellarator qui n’utilise que des champs magnétiques, sans courant électrique dans le plasma, et n’est donc pas « pulsé », mais il nécessite la réalisation de bobines magnétiques de formes extrêmement compliquées (ci-contre, une des bobines du Stellarator « Wendelstein 7‑X »).
ITER, et au-delà…
Alors que les phénomènes qui se déroulent dans le cœur d’un réacteur à fission sont presque tous linéaires, ce qui permet une extrapolation en taille facile (sur le papier), le phénomène de fusion est hautement non linéaire, notamment à cause des instabilités qui se développent dans le plasma pendant son confinement. On ne peut donc faire la démonstration de la faisabilité d’un futur réacteur que dans une installation où le plasma a déjà un volume analogue. C’est pourquoi, aujourd’hui même, on construit à Cadarache, dans une coopération carrément mondiale, le plus gros des tokamaks, appelé ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).
La construction d’ITER a été décidée en 1985 au Sommet de Genève. Le site de Cadarache a été choisi en 2005. La machine devrait être opérationnelle en 2020 et on espère qu’ITER pourra tester son premier plasma D‑T vers 2027. Ce sera alors, pour la fusion contrôlée, un peu l’équivalent de ce que fut pour la fission la divergence du réacteur CP1 d’Enrico Fermi, en décembre 1942. ITER devrait être capable de produire 500 MW de puissance de fusion pendant au moins dix minutes, avec seulement 50 MW de puissance de chauffage injectée : on voit le saut énorme en performances par rapport au JET.
Le coût du programme ITER est réparti entre les sept partenaires de l’Organisation internationale ITER : l’Union européenne (plus la Suisse, au titre de sa participation à Euratom), la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis, soit 35 nations. Sur la base des estimations effectuées, le coût du projet a été estimé à 12,8 milliards d’euros (conditions économiques 2008) pour les douze années de la phase de construction de la machine.
Les coûts liés à l’exploitation sont estimés à 5,3 milliards d’euros (conditions économiques 2000) sur environ vingt ans, à 280 millions d’euros (conditions économiques 2000) pour la période de cessation définitive d’exploitation, et à 530 millions d’euros (conditions économiques 2000) qui seront provisionnés durant la phase d’exploitation par les partenaires internationaux pour le démantèlement.
ITER doit démontrer la capacité à maintenir le plasma confiné sur de très longues durées (maîtrise des instabilités et des phénomènes de turbulences susceptibles de se produire dans des champs magnétiques très intenses), à confiner ce plasma tout en extrayant l’hélium, résidu de la réaction, réalimentant le plasma en tritium produit par capture de neutrons dans la « couverture » au lithium. Bien sûr, il a fallu maîtriser la construction des composants de grande taille, et développer la robotique pour remplacer les composants très irradiés. Tout cela, dans une organisation internationale très (trop ?) complexe.
Par ailleurs, ITER sera le premier tokamak qui fera l’objet d’une procédure complète d’autorisation par l’Autorité de sûreté française, à l’instar d’une centrale nucléaire, ce qui conduit notamment à prendre en compte les dispositions d’assurance de la qualité de niveau nucléaire pour toutes les fabrications de composants qui jouent un rôle sur le plan de la sûreté.
Mais ITER ne sera pas un réacteur au sens habituel du terme : au cours des vingt ans où l’on étudiera son fonctionnement, il consommera beaucoup plus d’énergie qu’il n’en produira. De plus, s’il doit prouver la faisabilité physique de contrôler un plasma D‑T de grande taille, il n’apportera pas la démonstration technologique, sans évidemment parler d’évaluation économique.
En effet, une fois la physique démontrée, les défis technologiques resteront énormes : ingénierie d’ensemble, car la configuration fermée d’un tokamak ceinturé par toutes ses bobines se prête mal à la structuration de tous les circuits nécessaires à la production d’électricité en continu dans un réacteur industriel, et, surtout, mise au point de matériaux capables de résister le plus longtemps possible aux rayonnements thermique et neutronique beaucoup plus intenses que ceux que l’on trouve dans un réacteur à fission, sans produire de trop grandes quantités de déchets radioactifs.
C’est pourquoi il est prévu, après ITER, de passer à la conception et à la réalisation d’un premier vrai réacteur DEMO, qui pourrait être suivi d’un ou plusieurs prototypes, menant plus tard à une série, si les conditions de compétitivité économique le permettent.
La fusion par confinement inertiel (FCI)
Si l’avis général des spécialistes est que la FCM est la voie la plus prometteuse pour parvenir à la production d’électricité par fusion, les études sur poursuivent sur une voie diamétralement opposée, la fusion par confinement inertiel, directement dérivée de la bombe H.
Alors qu’un plasma de FCM est d’une densité si faible qu’elle s’apparente à un vide de bonne qualité, la FCI consiste à comprimer énormément un mélange D‑T jusqu’à atteindre une densité environ 1 000 fois supérieure à celle d’un solide, toujours à 100 millions de degrés, mais avec un temps de confinement de l’ordre du milliardième de seconde…
Pour ce faire, on fait converger sur une petite cible sphérique remplie du mélange D‑T les faisceaux de 200 lasers de très forte puissance : l’enveloppe de la cible se volatilise, ce qui provoque une implosion qui comprime le mélange jusqu’aux conditions où la fusion se produit. Deux très grandes installations sont consacrées à la FCI : la NIF (National Ignition Facility) à Livermore (Californie) et le LMJ (laser mégajoule), en fin de construction près de Bordeaux. Les cibles font quelques millimètres de diamètre, et la chambre où se déroule l’implosion en fait dix mètres !
Les études de FCI ont pour but principal le calage expérimental des codes qui servent à concevoir les armements thermonucléaires, depuis l’arrêt des tests en vraie grandeur. Certains considèrent cependant que la FCI pourrait aussi permettre un jour la production d’électricité. Aujourd’hui, il faudra sans doute au moins une semaine après un « tir » pour reconstituer dans le bâtiment expérimental les conditions d’un tir suivant. Pour la production d’énergie, il faudrait probablement pouvoir réaliser un tir par seconde…
Avantages, inconvénients et perspectives
Quand la fusion sera une réalité industrielle, elle offrira beaucoup d’avantages :
• sûreté intrinsèque : la fusion n’est pas une réaction en chaîne qui pourrait « diverger », et il y a très peu de matière fusible dans la machine (quelques milligrammes) ;
• cycle du combustible intégré : on fabrique le tritium sur place, et il n’y a pas de transport de combustible ;
• les « cendres » de la fusion (l’hélium) sont inoffensives ;
• les ressources de lithium sont très abondantes, et celles de deutérium presque illimitées ;
• si les matériaux de structure sont bien choisis, pas de déchet radioactif de longue durée de vie.
Mais les problèmes sont encore considérables :
• un réacteur à fusion sera encore beaucoup plus complexe qu’un réacteur nucléaire actuel ;
• il y a un effet de seuil (le volume de plasma pour la FCM ou l’énergie de l’implosion pour la FCI) : impossible de concevoir un réacteur à fusion de taille petite ou moyenne ;
• les matériaux et l’architecture sont encore à inventer ;
• il y aura de grandes quantités de déchets radioactifs – de courtes durées de vie si on trouve les matériaux adéquats – à cause de l’activation des structures par les neutrons ;
• il est impossible de prévoir aujourd’hui quel sera le coût de production de l’électricité par fusion nucléaire.
Autant dire que l’enjeu est d’importance, mais que la route est encore longue avant que la fusion puisse contribuer à l’approvisionnement du monde en énergie.
Illustration : le Soleil, sous différentes longueurs d’onde. La fusion nucléaire constitue le mécanisme à l’origine du rayonnement des étoiles et en particulier du Soleil (© DR)


















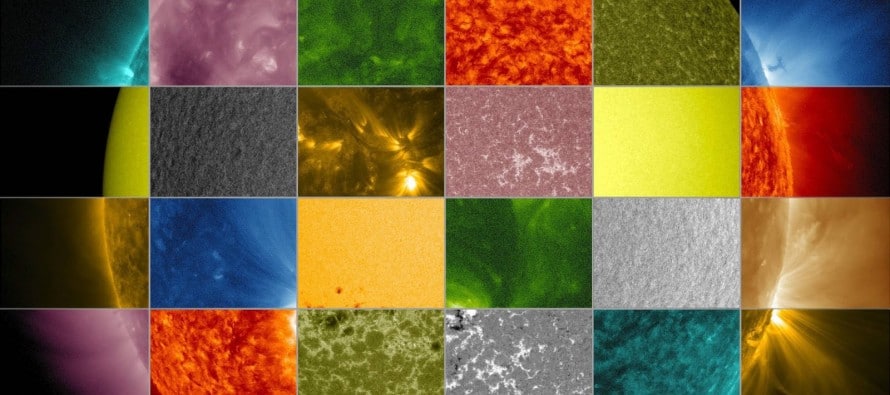







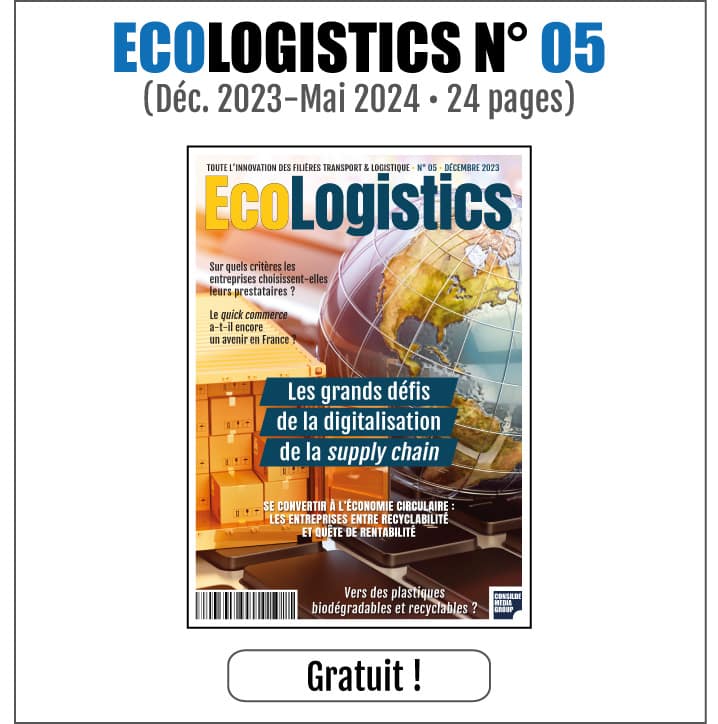

Ajouter un commentaire